Sur le front

Lors du décès du chanteur juif montréalais Léonard Cohen le 7 novembre 2016, un commentaire de ce dernier sur la guerre a circulé sur les réseaux sociaux pour disparaître ensuite rapidement, tant il était incompréhensible et choquant pour la plupart de ses admirateurs. Dans une interview donnée à son retour aux USA après avoir participé à la guerre du Yom Kippour de 1973 en Israël, Leonard Cohen exprima en effet son enthousiasme pour la guerre en ces termes : « War is wonderful. They’ll never stamp it out. It’s one of the few times people can act their best. There are opportunities to feel things that you simply cannot feel in modern city life. »[1]
Hors de toute dimension politique ou idéologique, Léonard Cohen dévoile ici un paradoxe que j’ai eu souvent l’occasion d’éprouver pendant mes 14 années de missions humanitaires dans les zones de conflits en Afrique Centrale avec Médecins Sans Frontières. Le jésuite Teilhard de Chardin, qui était brancardier pendant la Première guerre mondiale et qui reçut la Légion d’honneur pour sa bravoure, a exprimé ce paradoxe de manière convaincante en ces termes : « Le front attire invinciblement parce qu’il est, pour une part, l’extrême limite de ce qui se sent et de ce qui se fait. Non seulement on y voit autour de soi des choses qui ne s’expérimentent nulle part ailleurs, mais on y voit affleurer, en soi, un fond de lucidité, d’énergie, de liberté, qui ne se manifeste guère ailleurs, dans la vie commune. »[2]
Une expérience inexprimable
Ce dernier point est sans doute un des plus difficilement exprimable lorsque l’on tente de raconter une expérience de secours humanitaire en contexte de guerre et c’est du reste une dimension plutôt taboue entre les secouristes humanitaires eux-mêmes. Le célèbre Général sudiste de la guerre de Sécession américaine, Robert Edward Lee, l’a résumé dans une phrase lapidaire désormais célèbre : « Heureusement que la guerre est une chose horrible – sinon nous pourrions l’apprécier. »[3]
Dans une tout autre perspective, le sociologue Émile Durkheim documentant la guerre franco-prussienne de 1870-1871[4] remarquait que le taux de suicide diminuait considérablement en temps de guerre, laissant entendre que les formes de cohésions sociales qui peuvent exister en temps de conflit – et que nous ignorons en temps de paix – ne sont pas à négliger.
Bien sûr, « nul ne sait ce qu’est la guerre, s’il n’y a son fils »[5], a déjà dit avec sagesse Joseph de Maistre et il ne s’agit ici aucunement de légitimer la guerre ou de faire l’éloge des atrocités commises en zone de conflits armés, mais plutôt de regarder en face une disposition que l’on retrouve aussi curieusement au cœur de la pratique de la méditation.
L’autre visage de la peur
Car contrairement à l’image de détente aseptisée qui en est donnée, il est impossible de méditer sans affronter sérieusement la peur, l’angoisse et la douleur. En retour et d’une manière qui peut paraitre étrange pour le sens commun, le risque, le courage et l’aventure sont des dimensions centrales de la voie de la méditation.
Qu’est-ce que méditer? C’est tout simplement être assis par terre le dos droit, sans bouger. C’est tout. Et quiconque le fait pour de bon va nécessairement rencontrer la peur et l’angoisse sans possibilité de les fuir, à l’image du brancardier sur la ligne de front.
Dans son ouvrage de 2005 sur la chevalerie, Fabrice Midal appelait à se confronter à cet étrange paradoxe qu’a nécessairement rencontré Léonard Cohen ou Teilhard de Chardin : « Plus nous agissons malgré la peur, plus celle-ci diminue. En revanche, plus nous la laissons nous paralyser, guider notre conduite, plus son empire sur nous est puissant. (…) Faire l’épreuve de la peur, la ressentir, nous donne une énergie extraordinaire qui nous porte en avant. On pense généralement que la peur inhibe. C’est en fait tout le contraire. »[6]
Loin d’être un refuge commode pour se mettre en sécurité, la méditation est sans doute une des pratiques les plus à même de nous permettre d’affronter la peur et surtout de découvrir l’autre visage de la peur. Il peut y avoir encore une part de lâcheté chez les différents acteurs des guerres conventionnelles, une manière de voiler sa peur dans l’activisme, le ressentiment ou la vengeance par exemple. Alors que dans la méditation pratiquée sur le long terme, il ne reste plus d’échappatoire.
…
Philippe Blackburn
Montréal
[1] http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=11943
[2] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. 1997. Genèse d’une pensée. Lettres 1914 – 1919. Paris : Bernard Grasset.
[3] MCPHERSON, James. 1991. La guerre de Sécession (1861-1865), Paris : éditions Robert Laffont.
[4] STORA-LAMARRE, Annie. « La guerre au nom du droit », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 30 | 2005, mis en ligne le 01 avril 2008, consulté le 23 novembre 2016.
URL : http://rh19.revues.org/1017 ; DOI : 10.4000/rh19.1017
[5] DE MAISTRE, Rodolphe. 1853. Lettres et opuscules inédits du comte J. de Maistre. Paris : Vaton.
[6] MIDAL, Fabrice. 2005. L’Esprit de la chevalerie. Des atouts pour l’homme moderne. Paris : Presses de la Renaissance., p.185


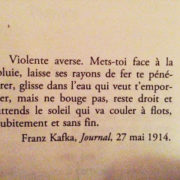








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !