Accueil / Le blog des enseignants / Révélation de la lumière, révélation de l’espace
Révélation de la lumière, révélation de l’espace

Effacement paradoxal des formes…
Turner, ce regardeur infatigable qui a parcouru son Angleterre natale et l’Europe entière pour contempler la diversité et la somptuosité des paysages finit paradoxalement par les faire apparaître de telle sorte que nous ne pouvons plus en distinguer aucun détail, ni presque aucun contour ! Il semble étrangement que plus il les observe, moins il les voit, du moins si l’on entend par là qu’il en discerne les formes.
Et pourtant ! Il déclare bien : « Je peins ce que je vois, et non ce que je sais être là ». Ce qu’il sait être là, c’est une montagne, un port, une tempête, un Yacht approchant de la côte, une Mer agitée avec des dauphins. Probablement, ces deux titres qui désignent les derniers tableaux exposés actuellement au Musée Jacquemart André (Turner, collection de la Tate, 26 mai 2020, 11 janvier 2021) désignent-ils ce qu’il sait être là, mais il a peint, restitué pour nous, ce qu’il a vu.
Or, qu’a-t-il vu, à en juger par ces œuvres ? On serait tentés de répondre : « rien » ! Car nulle chose, nul « étant » n’est, à proprement parler, visible !! Pas plus de « dauphins » que de « yacht » ! À moins qu’on désigne par ces mots, les trois allusions blanches à l’allure de voiles, qui évoquent discrètement un bateau. Mais elles sont noyées dans un océan de couleurs, renvoyant à la mer sans qu’elle soit, elle non plus, « représentée ». Plus il observe les paysages, et il n’a cessé de le faire, peignant souvent « sur nature », plus leurs formes s’estompent.
Car, ce qui l’intéresse de ces paysages, c’est la lumière. Non « ce que » la lumière met en lumière, mais la lumière elle-même. À mesure qu’il peint, ses toiles ne font donc presque plus rien apparaître, ou plutôt, elles font apparaître : « rien ».
La lumière singulière de chaque paysage
Ainsi, nous retrouvons-nous placés face à un phénomène bien paradoxal : un des observateurs les plus assidus de la nature nous l’a montrée de telle façon qu’on ne puisse finalement plus l’identifier ! Là où le regard d’un peintre comme Chardin nous fait apparaître le pot en étain ou la tabatière, avec une précision qui ne nous était jamais apparue auparavant, Turner engloutit les choses dans la lumière qu’elles révèlent. Ce qu’il voit des « choses », ou à partir des choses : c’est leur lumière. De fait, chacun de ses tableaux montre bien la lumière de ce paysage-là ! Sans en lire les titres, et même si nous ne voyons pas une « représentation » de la mer, nous ne pouvons confondre un tableau évoquant la mer et un autre se référant à une montagne.
Certes, cela tient sans doute à ceci que la suggestion, aussi allusive soit-elle, est suffisamment puissante et habile pour renvoyer à un paysage anglais, à une tempête, à Venise, à la vitesse d’un train, ou autre. Mais pas seulement ! C’est bien la lumière de chacun de ces éléments que Turner parvient à montrer, chaque paysage ayant sa propre coloration et sa mouvementation lumineuses. Ce qui permet de comprendre que, malgré l’imprécision des contours des « choses » évoquées, Turner ait eu besoin de les voir et de les revoir encore, pour parvenir à nous montrer leur lumière ! Ou encore, de comprendre que plus il peint, plus les formes s’estompent. Là où l’observation produit habituellement un surcroît de détails, ici, elle les efface.
À la source du visible
Renversement : ce n’est plus la lumière qui fait apparaître les « choses », mais celles-ci qui la font resplendir. Habituellement, la lumière révèle les choses, ici, c’est le contraire. Turner ne s’est pas placé dans un atelier de peintre, pour imaginer la lumière, et l’attribuer arbitrairement à tel ou tel élément visible, à partir d’un souvenir plus ou moins vague, ou par une invention de coloriste. Non, il s’est transporté, en chair et en os, et d’années en années, dans la nature, pour rendre visible la lumière d’un paysage italien, celle de la campagne anglaise, d’une montagne française. Autrement dit, ce chasseur de lumière rend visible ce qui rend visible.
Impossible, sans le regard du peintre, de regarder la lumière en tant que telle ! Nous y perdrions la vue. Or, par son geste, nous pouvons la contempler. À strictement parler, nous ne voyons plus rien, ou presque, sur ses tableaux, de ce que la lumière met en lumière ! Mais pourtant, le travail de Turner, qui ne prenait jamais de vacances, et ne voyageait que pour travailler, consistait à contempler inlassablement les paysages, sources de ses peintures, et à nous mettre sous les yeux la source de leur visibilité.
Il est saisissant, mais logique, de constater, que, ce faisant, tout motif, supposé à l’origine de sa composition, ait progressivement disparu pour ne laisser apparaître que ce qui nous les rend ordinairement visibles ! Pour voir ce qui rend visible, à savoir la lumière, il faut ne plus voir le visible ou les visibles. Un certain rapport à la lumière efface le visible.
La lumière comme éclatement de l’espace et comme désencombrement du monde.
Elle n’est plus alors qu’ouverture de l’espace. Nous sommes placés face à l’origine de toute visibilité. Tout se passe comme si, à force d’observer les paysages, Turner n’en percevait plus que la spaciosité lumineuse. Comme si à force de regarder, il ne voyait plus que l’espace où tout peut prendre place. Il y a lumière, quand tout s’ouvre en un espace d’accueil, obscurité quand l’espace se ferme.
En regardant ces tableaux m’est revenu le titre étrange du livre de Jacques Lusseyran, où celui-ci raconte son expérience de la cécité : Et la lumière fut. En effet, Lusseyran y raconte comment, à son grand étonnement, il découvrit, quelques jours après l’accident qui le rendit aveugle, que s’il avait évidemment perdu la perception visuelle des choses, il n’avait, en revanche, et contre toute attente, pas perdu le rapport à la lumière : « il pleuvait partout de la clarté, plus un reste de nuit. Tout était d’or et d’argent comme si, des couleurs, je n’avais su d’abord accueillir que les plus aiguës, les plus précipitées… Au dehors, c’était désormais le vide ; au dedans toute une forêt de lumière. Je dus regarder longtemps avant de m’accoutumer à cette lumière sans ombre. <…> Cela éclairait en moi. Et moi, je n’étais qu’un lieu de passage, un vestibule pour cette clarté. »
La lumière n’a plus ici grand chose à voir avec un phénomène optique : quand Lusseyran se fait, par une attitude éclairée (!), juste lieu de passage de cette clarté, alors son rapport avec le monde devient spacieux et plein d’aisance. En revanche, si la peur et la colère le dominent, le passage s’obscurcit, et le monde lui devient hostile. « Lumineux » signifie ici : rapport au monde désencombré. « La tristesse, la haine ou la peur n’assombrissaient pas seulement mon univers, elles le rapetissaient, écrit Lusseyran. <..> Inversement, le courage, l’attention, la joie avaient pour conséquence immédiate, un éclatement de l’espace. »
De même, Turner se fait le vestibule d’une clarté qui nous désenglue des choses, en magnifiant l’espace, c’est-à-dire la lumière, qui les accueille. Par l’observation patiemment et incessamment réitérée des phénomènes qu’il voulait peindre, il restaure quelque chose de la fluidité, si souvent perdue, du rapport au monde. Tant s’en faut qu’il ne peigne alors que les paysages riants. Ce n’est pas une peinture à l’eau de rose ! Il peint tout aussi bien des tempêtes, et des incendies. Mais il en voit toujours la splendide lumière. Amis méditants qui avez si souvent entendu parler de l’espace lors de nos séminaires, l’exposition Turner du Musée Jacquemart André vous attend…
…
Danielle Moyse
Chennevières









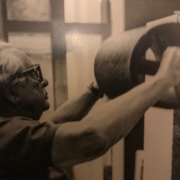









Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !