Accueil / Le blog des enseignants / Oser voir la violence du monde
Oser voir la violence du monde

En 1960, 15 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, la philosophe politique Hannah Arendt suivit pendant dix mois à titre de journaliste le procès d’Adolf Eichmann, haut fonctionnaire allemand responsable de la logistique de la solution finale pendant le génocide nazi. Ce procès médiatisé fut singulier à plus d’un titre, mais surtout en raison des propos contradictoires d’Eichmann, qui ne cessa jamais de plaider son innocence pour les actes perpétrés, tout en reconnaissant les avoir commis. Il se percevait comme un homme n’ayant fait que « suivre les ordres » d’un gouvernement élu démocratiquement, un homme qui avait fait son devoir de citoyen, et qui de surcroît n’était qu’un des multiples maillons d’une opération et d’une organisation dont la logique le dépassait entièrement.
Élevé « dans l’esprit chrétien le plus pur » [1], Eichmann « ne haïssait pas les juifs » selon ses propres dires. Il lui est même arrivé « d’intervenir en faveur d’un certain couple juif » pour les aider à quitter l’Allemagne. En 1943, en plein cœur des opérations d’extermination qu’il dirigeait et coordonnait, il « donna naturellement l’autorisation d’émigrer en Suisse » à la fille d’un de ses oncles par alliance – une demi-juive selon les lois de Nuremberg – qui était venue le voir en personne. Cet homme, Adolf Eichmann, est pourtant un des maillons essentiels de l’extermination de 6 millions de juifs pendant la deuxième guerre mondiale.
La banalité du mal
« Eichmann à Jérusalem », l’ouvrage d’Hannah Arendt qui parut après le procès, a comme sous-titre « Étude sur la banalité du mal ». Dans ce livre, qui fut à l’époque très mal reçu et mal compris, Hannah Arendt tenta de se confronter honnêtement à ce paradoxe : comment l’un des plus hauts responsables du génocide nazi pouvait-il n’être qu’un fonctionnaire ordinaire, simplement soucieux d’accomplir au mieux son devoir, sans mesurer la responsabilité personnelle qui lui incombait ?
La question se complique lorsqu’on découvre que ceci ne concernait pas seulement le cas d’Eichmann. Plusieurs soldats SS ayant participé au génocide à Auschwitz et qui ont comparu devant un tribunal après-guerre ont aussi nié toute culpabilité. Ils se considéraient comme de simples exécuteurs d’ordres, ce qui fit même dire au Juge Hofmeyer à Francfort en 1963 : « Je n’ai encore jamais rencontré personne qui ait commis quelque méfait à Auschwitz ». [2]
En exposant la logique de tout un système, Arendt éclaira aussi l’absence de révolte et la soumission de la grande majorité des victimes qui allèrent à la mort pratiquement sans réagir, creusant même parfois docilement leur propre tombe avant d’être exterminé. C’est l’effrayante efficacité d’un système qui transforme tout homme en victime apathique et presque consentante qu’Arendt a dévoilée.
C’est sous le terme de « banalité du mal » qu’Hannah Arendt tenta d’expliquer ce phénomène de prime abord incompréhensible : visiblement, la plupart des nazis n’étaient pas nécessairement des monstres hors humanité, mais de simples et pathétiques fonctionnaires.
En analysant ce phénomène, la philosophe mettait indirectement en cause beaucoup plus que la barbarie du régime nazi, d’où l’incompréhension – et parfois la violence – dont elle fut victime. Car en parlant de banalité du mal, de bureaucratie, de massification et d’organisations politico-économiques dont la logique nous dépasse, Hannah Arendt parlait aussi du présent, de ce monde que nous habitons – et aujourd’hui plus que jamais.
Violences contemporaines
Car jamais n’avons-nous en effet été autant asservis à un lourd système hétéronome sur lequel nous n’avons aucun contrôle et aucune prise. Tous nos besoins primaires, de la nourriture jusqu’au transport en passant par l’habitat, sont désormais insérés dans la complexité d’un système techno-libéral-virtuel globalisé qui nous dépasse entièrement. C’est donc le politique, l’être ensemble et l’espace public qui deviennent virtuels. Et les petits arrangements ne résolvent rien quant à l’essentiel. Dans ce cadre, le risque de devenir de petits Eichmann et de se transformer en « spécialiste de la résolution de problèmes », selon l’expression d’Arendt, nous pend donc au nez à tous.
Et en effet, être tenus à distance de tout, de telle manière que plus personne ne soit responsable de rien, pose des questions éthiques abyssales, car nous prenons part à la violence du monde sans le vouloir. On s’offusque des propos d’Aristote pour qui l’esclavage était un mal nécessaire, au moment même où notre mode de vie, de l’achat d’une chemise « made in Bengladesh » jusqu’à l’aller-retour Paris-Montréal en avion réservé sur notre nouveau Iphone, peut impliquer des formes d’esclavages et de violence envers le monde beaucoup plus importantes que celles qui existaient chez les Grecs. Aristote avait au moins la possibilité de respecter – ou non – ses esclaves, alors que nous sommes complètement coupés des gens qui fabriquent nos objets, tout comme du monde où ils sont produits. Réduits à l’état de « coûts de production » dans l’horizon tracé par un univers uniquement orienté par la productivité, l’efficacité et le profit, les humains, les animaux et le monde sont-ils autre chose que des outils et des rouages de la méga machine ?
Certains analystes ont soutenu qu’Eichmann avait été incapable d’affronter la réalité parce que son crime était en fait partie intégrante de cette réalité. Est-ce notre situation à tous aujourd’hui ?… La question peut être posée.
Comprendre la violence propre à notre temps est donc une obligation éthique incontournable. C’est pourtant beaucoup plus difficile à faire qu’il n’y parait au premier abord. Les analyses politico-sociales contemporaines qui approfondissent les mutations incessantes du phénomène de la mondialisation sont légions, mais nous aident-elles pour autant ? Englués dans un flot continu d’informations, submergés par l’écho apocalyptique d’inquiétantes abstractions qui prennent tantôt le visage de la crise climatique, des tensions migratoires, de la bombe démographique, des nouvelles fractures sociales, du fossé grandissant entre les grandes villes mondialisées et leur périphérie, de l’effondrement possible et probable de notre civilisation – le tout entrecoupé de spots publicitaires personnalisés – qui est encore en mesure de se relier au monde avec justesse ?
Les médias, disait Georges Bernanos en 1944, sont un « crime organisé contre l’esprit. (…) La plus redoutable des machines, une machine à bourrer les cranes, à liquéfier les cerveaux. Être informé de tout et condamné ainsi à ne rien comprendre, tel est le sort des imbéciles. » [3]
Ne pensez pas, regardez
Le philosophe autrichien Ludwig Josef Johann Wittgenstein, qui aurait sans doute été ici en accord avec ce constat de Bernanos, a dit un jour : « Ne pensez pas, regardez ». Car c’est bien d’apprendre à voir dont nous avons aussi besoin de toute urgence. Rien n’est plus difficile que de simplement regarder. Et ici, la méditation peut être d’une aide véritable. Ce fut du moins le cas en ce qui me concerne. C’est qu’en nous posant, la pratique de la méditation nous invite à faire l’épreuve pour de bon de la situation. C’est ce que nous refusons de faire la plupart du temps, préférant la dernière idéologie politique à la mode ou la fuite dans le divertissement.
Je donne fréquemment des cours sur la mondialisation et les guerres contemporaines à des étudiants en médecine, en anthropologie, ainsi qu’en science politique à l’Université de Montréal. Je cherche toujours au départ à mettre l’accent sur la mondialisation et la forme de rapport au monde qu’elle induit et qu’elle implique. Mon souhait de départ est de tenter de sortir de l’abstraction qu’un tel exposé peut suggérer et d’ancrer la réalité de la mondialisation dans le concret de la classe. J’ouvre ainsi souvent ces cours en demandant aux étudiants s’ils connaissent la personne ou l’entreprise qui a fabriqué leurs souliers, leurs chaussettes, leurs pantalons… et ainsi de suite jusqu’à leur demander s’ils connaissent la personne ou l’entreprise qui a fabriqué les bureaux de la classe et jusqu’aux bâtiments de l’université. Mais encore, connaissent-ils la provenance des matériaux ayant servi à la fabrication du monde qui est le nôtre, du banc d’autobus jusqu’aux lacets de chaussure ? Qui a cultivé les légumes du repas du midi ? D’où vient la matière même de notre existence ? Nul ne le sait bien sûr : car nous sommes complètement étrangers au monde. Et si le constat est au fond assez banal, nul n’a réellement envie d’éprouver et de penser à ce que cela implique. Car si on ose le voir pour de bon, nous devons nous confronter à une perte de repères radicale que peu de gens peuvent supporter. Comme le dit Fabrice Midal dans son ouvrage sur Auschwitz, pour l’homme désormais, « nul enracinement n’est plus donné. Nous avons à habiter l’exil. » [4]
Cette violence qu’est l’abstraction et la mise à distance du monde est sans doute un des points les plus méconnus et les plus sous-estimé pour comprendre le désarroi contemporain. Elle produit en retour un enfermement dans la subjectivité qui convoque une fragilité psychique tout à fait nouvelle. L’aventurier Gérard Chaliand, 85 ans, géopoliticien de terrain qui a parcouru les guerres contemporaines depuis plus de 60 ans, constatait dernièrement que « les sociétés européennes sont d’une sensiblerie quasi maladive : on ne peut plus rien supporter. À la campagne, jadis, égorger un poulet, c’était aussi normal qu’aller faucher le blé. Aujourd’hui, vous dites à un type de n’importe quelle université, « On va manger un poulet mais il faut l’égorger ». Il vous répondra : « Ah non ! Pas moi ! [5] »
Prendre la mesure de l’abime
La violence qui pose aujourd’hui de réelles questions n’est pas celle qui nous saute aux yeux. Osons un peu de lucidité en affrontant ce paradoxe : Eichmann était le premier à se dire sensible et non violent. Lui aussi n’aurait sans doute pas pu égorger un poulet. « Encore aujourd’hui, a dit Eichmann à son procès, je suis absolument incapable de regarder une blessure béante. Je suis ainsi fait. On m’a dit très souvent que je n’aurais jamais pu devenir médecin » [6]. Lors de ce procès, il a aussi confié se sentir encore coupable d’avoir donné 20 ans auparavant une gifle au docteur Josef Löwenherz, leader de la communauté juive de Vienne, dans un moment d’exaspération. S’étant tout de suite excusé auprès du docteur Löwenherz, il ne put effacer sa culpabilité face à cette évènement banal. En retour, il n’a pas pleuré les 5 millions de juifs qu’il a fait acheminer vers la mort.
À nous de prendre la mesure de l’abime – qui nous concerne aussi en premier chef. Quitter la rêverie et la naïveté : donner une gifle ou égorger un poulet soulève aujourd’hui beaucoup moins de questions éthiques que le simple fait de se faire livrer un livre par Amazon. Voir la violence du monde dans son visage contemporain et ne pas fuir dans des espoirs faciles – à commencer d’ailleurs par la méditation ou les nouvelles spiritualités qui peuvent être vues comme un lieu pour fuir le monde – est la condition première d’une véritable libération.
Nulles solutions faciles à proposer – qui en possède ? Mais une certitude que rien de sérieux ni de vrai ne peut être accompli sans voir et assumer cette violence qu’est l’abstraction et la mise à distance du monde – ce que la philosophe Simone Weil nommait le « déracinement » [7] – et qui signe invariablement notre condition contemporaine.
…
Philippe Blackburn
Montréal
[1] ARENDT, Hannah. 1991. Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal. Paris : Gallimard
[2] MIDAL, Fabrice. 2010. Risquer la liberté. Vivre dans un monde sans repères. Paris : Seuil., p.41
[3] BERNANOS, Georges. 2005 (1944). La France contre les robots. Paris : Le livre de poche., p.216
[4] MIDAL, Fabrice. 2012. Auschwitz, l’impossible regard. Paris : Seuil., p. 207
[5] CHALIAND, Gérard. « Pour les pays occidentaux, les attentats, c’est du spectacle ». 24 mai 2017. Le comptoir
[6] ARENDT, Hannah. 1991. Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal. Paris : Gallimard
[7] WEIL, Simone. 1990 (1943). L’Enracinement, Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Paris : Gallimard





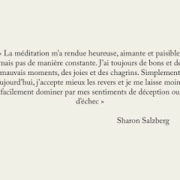





Salut Philippe!
Très belle analyse, merci!
J’irais plus loin sur un point: on retient souvent de ce livre qu’Eichmann « n’a fait qu’exécuter les ordres », ce qui peut induire en erreur, car en réalité il avait autour de lui un système juridique (et un discours politique) légitimant ces ordres. C’est un des paradoxes que relève Arendt, et qui lui a valu les critiques des intellectuels juifs: peut-être le seul acte purement illégal, dans cette affaire, fut l’arrestation d’Eichmann sur le territoire argentin par des agents israéliens…
La question qui se pose sous cet angle, c’est celle de la nécessaire transgression de la règle lorsque celle-ci est absurde (voire, dans le cas d’espèce, atroce). Et là l’intelligence « individuelle » (même si c’est un mot tabou pour certains), s’avère un rempart aussi salutaire qu’inévitable.
Quant à se relier aux autres et au monde en voyant leur réalité crue, c’est-à-dire débarrassée de toute conceptualisation, la méditation est un chemin, comme tu le sais l’engagement sur le terrain en est certainement un autre, pour qui n’y va pas encombré d’idéologie.
Somme toute, je suis content de voir qu’à l’EOM on parle plus d’Arendt et moins d’Heidegger…
Encore une fois, je te rejoins entièrement sur le fond. Merci pour ce beau texte.
Amitiés!
Oui, c’est très juste ce que tu dis Aldo.
Merci pour le commentaire.